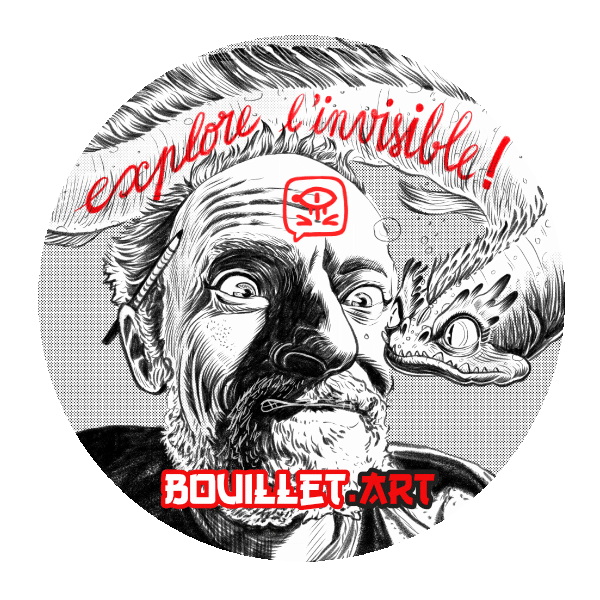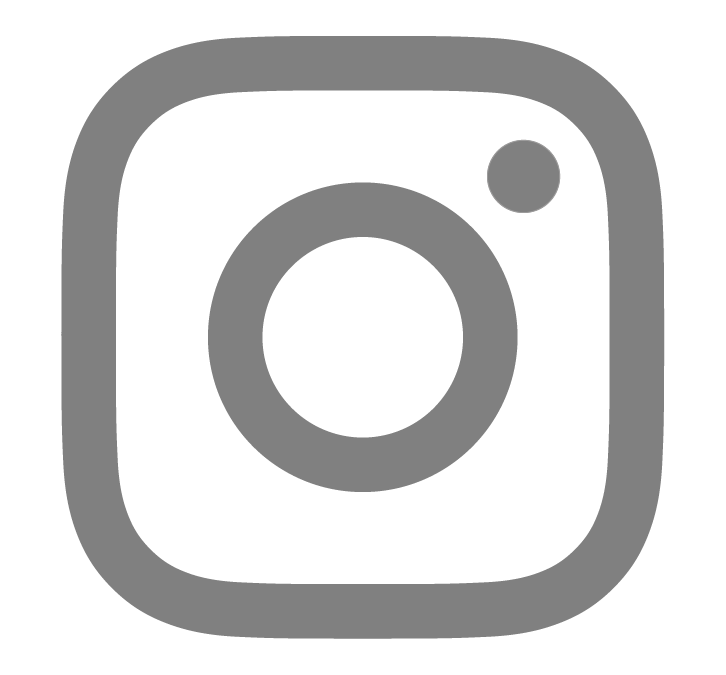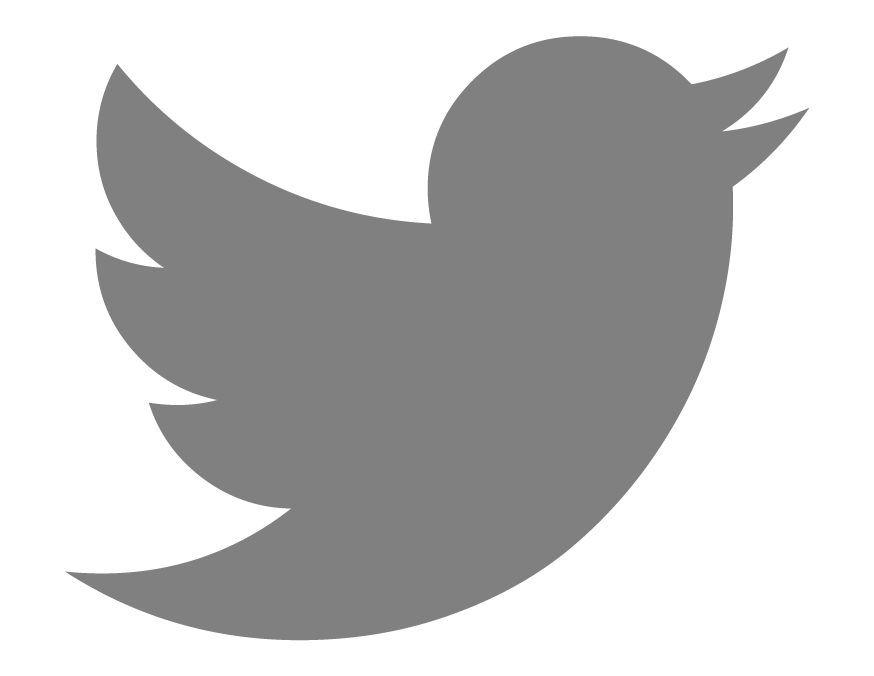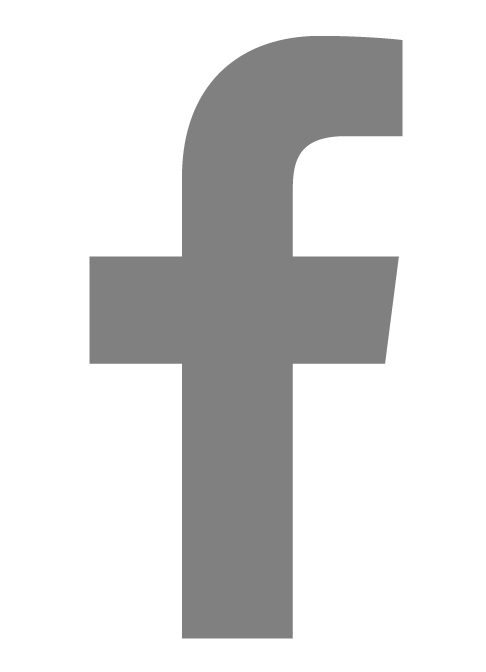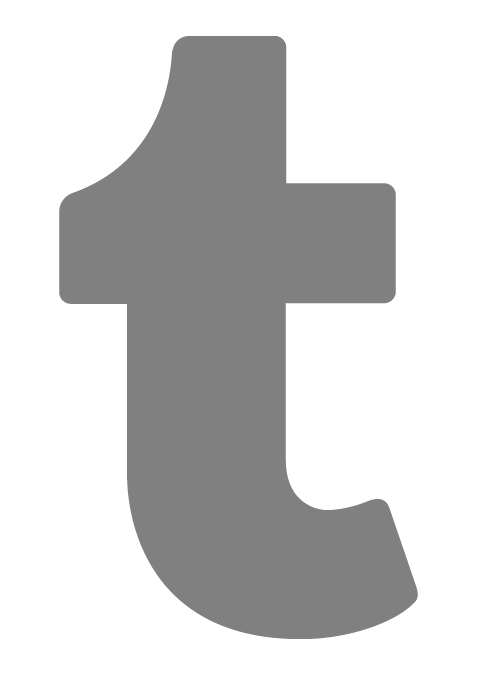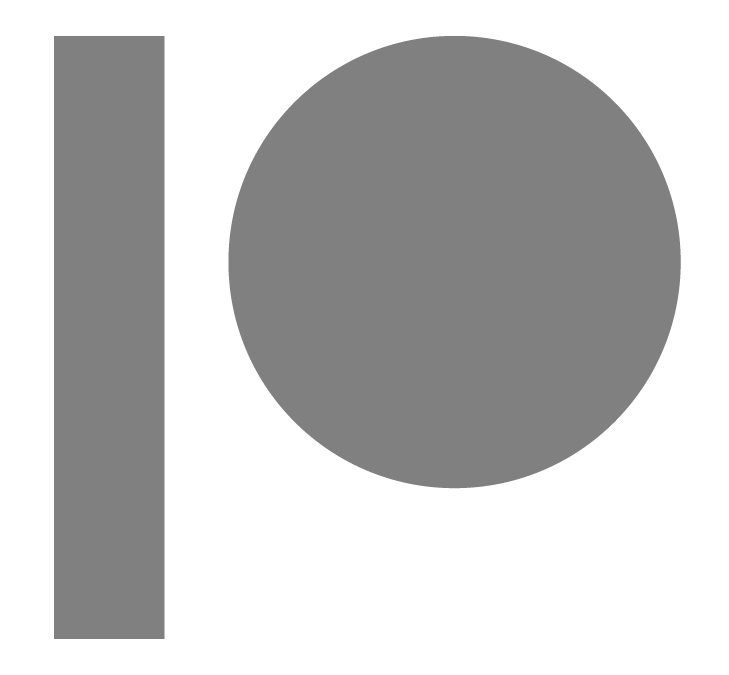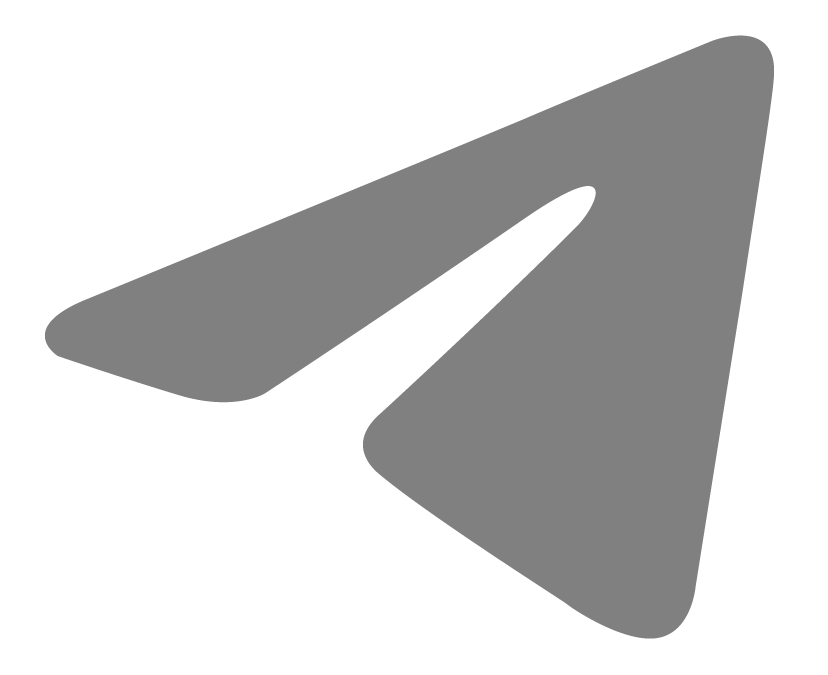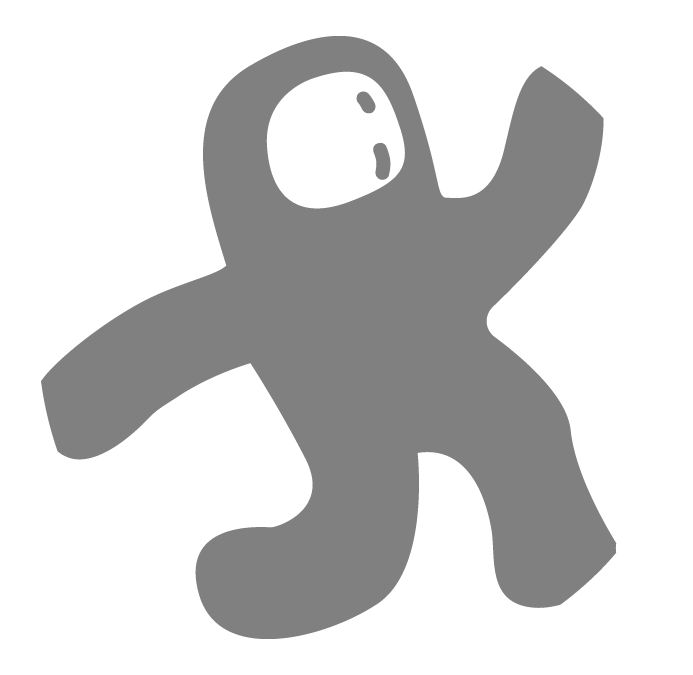Courir pieds nus en forêt fait un bien fou. Mais n’est-ce pas sans danger ?
Et si l’on rencontrait un gros animal effrayant ? Parviendrait-on à s’en sortir ?Cette nouvelle est issue d'un scénario BD romancé qui devrait paraître dans un fanzine collectif.
A LIRE aussi en PDF.
Cette nouvelle existe en BD : › lire les 8 pages BD de La rencontre du cerf sacré
-------
Purée… ça fait un bien fou. Et cette sensation d’euphorie indescriptible m’envahit à chaque fois que je mets un pied en forêt : un sourire automatique se dessine jusqu’à mes oreilles. Instantanément. Je me dis parfois que la magie ne va pas opérer, mais si : forêt = smile.
Quelle peut en être l’origine ? Est-ce le fait d’être pieds nus ? Impossible : je bosse pieds nus. Et c’est clair que je n’ai pas toujours le smile au boulot. D’ailleurs, mes assistantes au studio manga mettent toujours un certains temps à s’habituer à mes habitudes “vestimentaires”, et ce d’autant plus quand les rigueurs humides de l’hiver s’installent.
Si ça n’est pas le bare-footing, ça doit sûrement venir de la forêt en elle-même. Ou du contact avec la terre : un ré-équilibrage énergétique semble s’amorcer dès la première seconde entre la plante de mes pieds et l’humus. Un sol brut. Naturel. Pas comme ce carrelage froid et encore moins cet ignoble goudron, cancer de pus noir sorti du tréfonds de la planète. Non, simplement de la terre argileuse contre mes pieds nus.
D’ailleurs, cette sensation de bien-être se transforme littéralement en extase quand le sol est boueux : la sensation est exquise quand cette main minérale me masse la plante des pieds et passe ses doigts de velours en remontant entre mes orteils… Ahhh… Rien que d’y penser…
Nul doute que mon stress s’échappe par cette voie naturelle : celle des pieds nus au contact de la boue. Mais aujourd’hui, le sol est assez sec, déshydraté par plusieurs semaines d’un été indien très agréable dans nos forêts habituellement sombres et humides. La magie opère néanmoins, et puis… je trouverai bien une flaque de boue rafraîchissante !
Quelques foulées plus loin, les effluves des fleurs et des arbres remplissent mes narines grandes ouvertes, avant de serpenter jusqu’au fond de mes alvéoles, prémices à un bien-être global : la sylvothérapie a le vent en poupe en ce moment, comme si cet abruti d’Humain comprenait seulement maintenant qu’il n’est qu’un vulgaire Primate, fait pour vivre nu au sein des forêts tropicales. Et certainement pas dans de froides mégalopoles bétonnées, bruyantes et débordant d’ondes en tout genre…
En général, j’ai ma dose de nature pour toute la semaine quand je cours comme ça le dimanche après-midi. Un rendez-vous avec moi-même que je ne peux pas me permettre de louper, au risque de passer la semaine à broyer du noir en soupirant sans cesse, à pester contre les deadlines, les retards, la pression existentielle. Pffff… Des fois, je me demande si je ne devrais pas “juste” écrire des scénarios, au lieu de toujours tout vouloir faire toute seule, ou presque. Bon, heureusement que mes assistantes sont là, quand même, pour me soulager des aplats de noirs, et poser ces trames de gris en plastique mortel. Bref…
Après quelques minutes seulement, la sensation de transe me submerge : mon corps s’allège et mon cerveau hyperactif se vide comme une vieille chaussette qu’on essorerait. Les endorphines envahissent la moindre parcelle de mon anatomie. Finalement, le véritable opium du peuple n’est-il pas celui-ci ? Des opiacés naturellement produits… par nos propres cellules ! Pas besoin de saké, ni de fumer un de ces pétards débilitants et encore moins de se triturer des veines pourrissantes pour s’injecter un liquide mortel, ou de se gaver de pilules addictives mais légales, aux effets secondaires délétères… Non, rien de tout ça : juste courir. Pieds nus. En forêt. Et le moral repart.
Envolé le stress de la journée, et même de la semaine. Envolés les souvenirs cauchemardesques d’un passé trop présent et pourrissant un futur inexistant. Juste courir. Pieds nus. En forêt. De toute façon, en courant au naturel, on ne peut être que dans le présent, en pleine conscience, sans quoi les épines de ronces, racines et autres cailloux pointus nous rappellent à l’ordre, sans parler des châtaignes… Ça ne loupe jamais : une seconde d’inatt… POW !
Merde… C’était quoi ça ? POW ! Fuck me. La chaleur de ces dernières semaines m’avait fait oublier que nous sommes déjà fin septembre : la chasse est belle et bien ouverte. Fait chier : quand c’est pas ces motos-cross ou ces quads de merde, c’est les chasseurs qui tuent cette douce harmonie musicale des oiseaux et autres insectes. Ouais… Un silence de mort a envahit les bois…
Et c’est pas mes pieds nus, adaptés à des années de bare-footing, et amortissant la moindre foulée, qui laisseraient échapper un bruit, contrairement à leurs baskets technico-commerciales inutiles. Et comme à chaque fois que je croise des gâchettes faciles, la peur d’une balle perdue m’envahit d’un coup, alors qu’un frisson glacial parcourt ma peau suante.
Consciente de cette possibilité d’être prise pour cible par un aveugle du troisième âge ou un jeune abruti bourré d’adrénaline — à défaut d’autre chose — je porte toujours mon petit body rouge vif quand je vais courir en forêt. En plus de laisser une certaine liberté de mouvement à mes petits seins dodus et donc d’augmenter la sensation de courir nue, il devrait éviter, j’espère, à tout chasseur doté d’une parcelle de conscience, de me confondre avec une biche en chaleurs, un sanglier, ou n’importe quel autre bifteck sur pattes. Mon shorty aussi est rouge vif. C’est pas aussi fluo que leurs gilets oranges, mais au moins autant que les colliers de leurs clebs pleins de bave qui, même équipés de clochettes, se font plomber de temps en temps.
POW !… Ça vient de ma droite. “Non mais, c’est qu’ils se rapprochent ces abrutis !!”, criai-je dans leur direction en tournant la tête, dans l’espoir de me faire entendre.
Cette nano-seconde d’inattention suffit pour que mon pied glisse sur de la boue ou je ne sais quoi. Une intense douleur explose ma cheville droite. Le reste n’est que tournoiements et roulés-boulés dans une pente raide et feuillue, dévalant entre les arbres, jusqu’à un ruisseau saumâtre dont la fraîcheur me glaça le sang. FUCK. J’ai bien besoin de ça tiens.
Une rapide manipulation de mes mains me soulage : aucun doigt de cassé, sans quoi, adieu le manga ! Mais ma cheville, elle, me tiraille : mon pied est recouvert de sang… Un rapide nettoyage dans l’eau anormalement fraîche ne montre aucune coupure : sans doute le reste de l’animal mort sur lequel j’ai glissé en haut de cette colline. N’empêche, j’ai dû me fouler la cheville.
Soudain, mon cerveau se met en mode survie et mon mental se tait : au delà de l’odeur de pourriture et de décomposition des eaux stagnantes, plane un relent bien plus pénétrant et âcre : celui sans doute d’un horrible animal errant, dégageant une odeur encore plus insoutenable que celle des chiens crevés sur le bord des routes de nos vacances d’été. Ceux-là même qui, gonflant en plein soleil, finissent par se déchirer en libérant une armée d’asticots grouillants…
Je n’ose détourner le regard de ma cheville bleuissante, alors que mes sens en alerte répètent sans cesse la même réplique : cette lourde puanteur transpire la mort fraîche… C’est bien une odeur de sang chaud qui envahit l’air ambiant, comme des miasmes nauséabonds que je ne peux respirer.
“Bouge !!” me hurle mon cerveau paniqué. Tout en massant doucement ma cheville endolorie pour occuper mon stress, j’essaie de déglutir sans y parvenir, et relève lentement la tête, apercevant à moins d’un mètre de moi deux longues pattes noires et poilues plantées au sol comme des piquets, et qui soutiennent une énorme masse noire.
Un temps interminable s’écoule avant que je ne réussisse à distinguer une grosse tête oblongue, qui semble surmontée de deux grandes racines blanchâtres aux ramifications infinies et pointues.
Pas un souffle… Mon corps pétrifié ne veut plus bouger d’un poil, pas même respirer, figeant ma figure dans un rictus de terreur totale. Les battements de mon cœur surexcité martèlent mes tympans comme le bruit sourd de multiples tambours collés à mes oreilles. C’est alors que ce monstre poilu exhale un nuage de brouillard chaud et pestilentiel qui me fait grimacer de plus belle.
A travers cette brume bleuâtre et irrespirable, deux billes d’un jaune vif étincelant brillent de mille feux : son regard, d’abord noir et d’où émerge une étincelle de folie, s’apaise à son deuxième souffle, et n’est bientôt plus que vagues émergentes.
Je réussis à respirer à nouveau face à ce sombre géant des forêts, pour sentir sur ma peau moite un courant d’air glacial qui hérisse mes poils de bras.
La chose, enracinée là tel un arbre centenaire, halète péniblement, comme un mourant attendant sa dernière heure dans un lit d’hôpital. Seul. Mais habité par la bravoure de défier une dernière fois la mort.
Sortir de cette torpeur me demande un effort colossal : quand je peux enfin bouger, lentement, la douleur dans ma cheville se réveille, confirmant que tout cela n’est pas un cauchemar. Les genoux ancrés dans la boue, je tends finalement un bras hésitant et tremblant, chargé de la meilleure volonté et du peu de calme dont je suis alors capable.
Mes doigts touchent, puis grattent les poils de sa barbe dégoulinante de sang chaud auquel sont mêlés des caillots qui s’échappent de sa bouche et de ses énormes narines au gré de ses expirations. Je réussis ensuite à me lever, décollant mes genoux ankylosés de la boue froide.
Tandis que je longe son cou par la droite en gardant un oeil sur sa tête, le noir mastodonte me fixe soudainement. Je suis paralysée par la peur. Sans pouvoir lâcher son regard hypnotique, mon visage se charge d’un sourire crispé et désespéré et mon corps pivote lentement, avant de reculer, centimètre par centimètre, tout en caressant son torse d’une main droite ensanglantée.
Je m’éloigne enfin de cette tête énorme quand je sens sous mes pieds une substance chaude et gélatineuse. Je m’arrête à nouveau, mes yeux rivés dans le sien, avant de détourner le regard sur son torse, dont les poils noirs suants et fumants laissent transparaitre une zone de peau glabre impactée d’un trou noir béant et d’où coulent des amas de sang pâteux… sur mes pieds. Merde…
Le temps disparait. Il peut bien s’écouler dix secondes comme dix minutes, pendant lesquelles je demeure là, bouche bée, adossée à cet animal de malheur, comme obnubilée par ce trou noir et sanglant.
Je ne peux finalement m’empêcher de poser ma main gauche sur la plaie dégoulinante, comme pour la cacher, ou simplement ne plus voir ce flot intermittent de sang qui sort par magmas bouillants. Puis mon corps se relâche anormalement. Ma vision se trouble et devint noire comme si les poils de la bête envahissaient tout l’espace. Je me laisse submerger et emporter, en proie à une étrange légèreté…
—
Ce noir charbonneux laisse place à un blanc éblouissant. Après quelques temps d’accommodation oculaire, je peux enfin distinguer des formes, sentir des matières sous mes doigts : du tissu… une peau glabre… un tuyau en plastique attaché le long des veines noires d’un bras… squelettique. Des odeurs chimiques, alcooliques et javellisées intensifient la sensation de stérilité de cette pièce baignée d’une forte lumière artificielle.
Je suis dans une chambre d’hôpital, dont le silence n’est perturbé que par les bips répétitifs des machines électroniques de mesure. J’ai 7 ans, affalée de tout mon long dans le lit… de ma mère. Quand je lève les yeux, elle me regarde avec un sourire découvrant des dents cadavériques. Ses yeux lointains et jaunâtres, maquillés d’un sombre violet, dégagent un amour indestructible en même temps qu’une profonde lassitude de vivre.
Ses doigts arachnides m’agrippent en me serrant contre elle comme si elle devait y mettre ses dernières forces. Ses lèvres froides déposent un tendre baiser sur mon front en retenant un sanglot chaud.
Je m’envole soudain dans les airs : des bras sont en train de m’enlever. Je crie, râle et pleure en me débattant dans un élan de refus inaudibles. Au loin, les yeux de ma mère, comme des trous béants, laissent échapper deux grosses larmes rouges, telles des tiges de roses fanées cherchant racine dans ce paysage desséché.
Elle baisse la tête dans un soupir entendu, serrant contre elle ma peluche de cerf dont j’avais oublié l’existence. Noir.
—
Un noir tourbillonnant m’envahit à nouveau tandis que je reprends possession de mon corps. Mon bras gauche se consume, de l’épaule au bout de mes doigts crispés sur une sorte de petit caillou fuyant au sein d’un gluant magma biologique.
Quand j’ouvre les yeux, mon bras gauche a entièrement disparu dans le torse de l’animal, au niveau du trou de la plaie. “Je… euh… je suis… désolée…” bafouillai-je comme une gamine, arrivant à peine à surpasser les râles graves et vibrants de l’imposante bête noire. Complètement paniquée, je réussis néanmoins à retirer mon bras lentement, par à-coups, m’arrêtant à chaque plainte de l’animal, semblable à des échos résonant dans cette cuvette végétale moite où la lumière commence franchement à décliner.
Ma main droite recouvre aussitôt le trou rougeâtre et béant, alors que la bête soupire bruyamment et longuement, baissant son échine tremblotante et fumante comme si elle brûlait de l’intérieur dans cet air frais et gorgé d’eau.
Mon bras gauche, affublé de son long gant rouge de dentelle visqueuse, tremble sous des spirales de vapeur. Je réussis à plier le coude, inspectant alors cette bille de métal rougeoyante au bout de mes doigts, comme un ovni du passé hypnotique, et la laisse tomber au sol entre mes pieds qui baignent à présent dans une mare de sang chaud.
Étrangement, la plaie s’arrête de saigner très rapidement, et paraît même se refermer un peu. Le grand cerf me fixe, émet un petit râle bref, comme s’il voulait me parler. Instinctivement, je m’approche et pose mon front contre le sien : passée la première impression chaude et collante des poils hirsutes et puant le musc, mon front semble fusionner avec le sein, et s’ouvrir à des millénaires d’histoires, que j’absorbe en quelques secondes, tremblant telle une chamane luttant contre la possession d’un esprit trop gros pour elle.
Quand je relève la tête, des aboiements me parviennent aux oreilles. Proches. Trop proches. Fronçant les sourcils dans une résignation totale, je me peins rapidement quatre bandes rouges sur le visage, laissant glisser mes doigts dans un geste impulsif mais précis. Le massacre annoncé n’aura pas lieu aujourd’hui, pensai-je.
J’enjambe le ruisseau écarlate, remonte en courant la petite colline, en direction des chiens, habitée d’une énergie surnaturelle dont je ne me sentais plus capable. Puis je me mets à courir bruyamment mais de toutes mes forces. Sautillant, à droite, à gauche, gambadant comme une biche aguerrie, sautant par dessus les obstacles comme si je connaissais cette forêt sur le bout des orteils, prenant soin de laisser des traces de sang sur l’écorce des arbres, et au sol : les canidés ne doivent pas hésiter un seul instant.
Et c’est d’ailleurs très rapidement, malgré cette envolée fantastique, que les chiens assoiffés de folie se rapprochent, alors que les ronces lacèrent mes jambes, ma taille et bientôt mes bras. Les branches retiennent mes cheveux emmêlés et déchirent mes vêtements, que j’arrache finalement d’un mouvement brutal. Je dois le sauver, pensai-je dans ma course effrénée, gesticulant nue comme un gibier pris au piège. Il ne doivent pas me voir, suppliai-je en me roulant avec précipitation dans une mare de boue providentielle.
Allez !! Je peux les semer ! Je peux le faire ! Je vais y arriv… POW ! Merde, c’est pas passé loin !! Vite !! Je devrais peut-être POW !! Aïe. Qu’est-ce qu… Trou noir…
—
Deux chasseurs livides planent silencieusement au dessus de moi, dont les gueules suantes et déformées sont tiraillées entre effarement et perplexité, sans doute en proie à l’ineffable et terrible réalité qui s’impose à eux. Trou noir…
Des chiens virevoltent sans aucun bruit dans les airs, désarticulés… Trou noir… Silence de mort… J’aimerais tant dire quelque chose. Fuir cet instant. Mais mon corps, que je ne distingue même pas, ne réponds plus.
Les bois immaculés du cerf noir traversent l’espace, puis de part en part, transpercent le plus gros des chasseurs… Trou noir… Flashs lumineux.
La scène qui suit est encore plus étrange : elle semble me parvenir à travers un épais liquide mouvant et translucide. La réalité fuyante est devenue laiteuse et impalpable, de même que la perception de mon corps. Du moins de ce corps informe que je devine au loin. Le cerf s’approche de lui. De cette poupée disloquée et mise à nue, abandonnée au sol et camouflée de rouge et de terre sienne. Le gros animal se penche, lui parle… Oh ! Je… mon… corps…il bouge !
Le petit torse flasque et frêle se soulève et flotte littéralement dans les airs, sous la poussée de plantes aux tiges tentaculaires. La masse noire se rapproche encore, comme pour l’embrasser, et au lieu de ça, régurgite une sorte de lumière visqueuse qui s’écoule directement dans la petite bouche grande ouverte… En un éclair, je me sens aspirée par mon corps et me relève dans une bruyante inspiration, douloureusement réincarnée.
Après une quinte de toux sanguinolente et quelques haletantes bouffées d’air frais, je porte spontanément ma main sous mon sein gauche : une douleur diffuse s’estompe en même temps que je découvre et triture de longs poils noirs regroupés sur une sorte d’épaisse cicatrice molle.
Mes doigts, presque transparents, semblent habités par un courant lumineux azur, et me paraissent anormalement fins et agiles.
Le cerf, qui titube à mes cotés, a l’air aussi apaisé qu’épuisé. Il s’approche, et me lèche longuement avec sa large langue râpeuse et brûlante avant de m’aider à me relever. Puis sa tête poilue me pousse avec tendresse et fermeté vers son torse cicatrisé. Son mufle baveux se pose sous mon entrejambe et me lève d’un coup, comme une invitation à enjamber son dos poilu, ce que j’accepte volontiers, m’étalant aussitôt sur ce tapis animal en épousant le moindre de ses muscles suintants, entre des volutes protectrices de vapeurs musquées.
En enserrant son abdomen avec mes jambes, mes orteils boueux et sanguinolents touchent involontairement son membre en érection, le surprenant dans un petit râle de contentement qui laisse place à des soupirs étouffés au fur et à mesure de mes caresses langoureuses.
A demi consciente, mes doigts encore rougis effleurent mes lèvres, et s’engouffrent dans ce trou noir, goûtant enfin la véritable puissance de ce sang boueux. Je me surprends ensuite à lécher avidement chacun de mes doigts, me délectant de cette force vitale encore chaude, mélange d’une nature bestiale et magique, avant de m’agripper à nouveau : le voyage peut commencer.
—